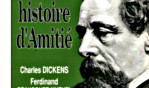Lefebvre, abbé François-A.
Histoire de Notre-Dame de Boulogne et de son pèlerinage
Liste des ouvrages

La cathédrale et basilique Notre-Dame - Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Boissié, Claudine
Inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France - région Nord-Pas-de-Calais - ville de Boulogne-sur-Mer, collection "Images du patrimoine", Lille, 1988.
In-4, broché sous couverture illustrée en couleurs, 72 pp.
Nombreuses illustrations en noir et blanc et en couleurs.
Bon état.
afficher le sommaire
L'ancienne église Notre-Dame - La reconstruction - Le mobilier de la basilique - Orfèvrerie - Autels, retables, tombeaux - Verrières - Sculpture - Peinture - Vêtements liturgiques - La sainte image.
Cet ouvrage a été réalisé par la conservation régionale d'inventaire du Nord-Pas-de-Calais à partir d'une enquête menée par Claudie et Pierre Boissié, conservateurs de l'Inventaire général, et Michèle Rougier, chercheuse à la conservation.
A l'origine des deux édifices religieux qui se sont succédés à Boulogne-sur-Mer, on trouve cette légende qui s'inscrit dans la tradition médiévale : "en des temps reculés, une statue miraculeusement apportée par les flots vint échouer en un lieu choisi, indiquant aux habitants que là devait s'élever un sanctuaire marial."
Le succès du pèlerinage médiéval entraîna l'embellissement et le remaniement constant de la cathédrale reconstruite à la demande des comtes de Boulogne à partir de 1104 ; vers 1400, la construction du grand portail offert par Jean de Berry "vint ainsi clore trois cents ans de chantier. C'est dans une somptueuse église de pèlerinage que Louis XI, en 1478, proclama la Vierge suzeraine du comté de Boulogne, passé à la couronne. L'acte royal para le sanctuaire d'un prestige accru." L'édifice ne se releva du siège anglais de 1544 et de l'iconoclasme huguenot , en 1567, qu'à partir du règne de Louis XIII. Au XVIIIe siècle, Mgr Partz de Pressy, évêque de Boulogne, fit détruire le portail offert par Jean de Berry et son épouse, Jeanne de Boulogne.
Fermée en 1793, vendue à l'encan en 1798, la cathédrale n'était plus qu'un champ de ruine au début du XIXe siècle.
La reconstruction de Notre-Dame fut l'oeuvre de l'abbé Haffreingue (1785-1871), fils d'un laboureur du Boulonnais, ecclésiastique à la vocation tardive et architecte autodidacte. En 1827, cet amateur se lança avec une détermination inouïe dans cette folle aventure qui devait pourtant arriver à son terme quarante ans plus tard, en dépit des méthodes techniques et architecturales peu orthodoxes de l'abbé. Rien ne passait chez lui par le dessin préparatoire (ses rares dessins témoignent d'une stupéfiante maladresse enfantine), l'étude rationnelle des poussées, mais tout reposait sur un empirisme quotidien et la pratique intime de l'écriture, dont témoigne son vaste journal. La pose de l'énorme coupole de quarante-sept mètres de diamètre, qui suscita tant d'inquiétude, devait marquer l'achèvement du chantier. Sa hauteur demesurée, qui doit beaucoup aux longues heures passées à arpenter le dôme de Saint-Paul de Londres, en faisait un phare symbolique de la catholicité face à l'Angleterre. En 1879, l'église que l'abbé Haffreingue avait légué à la municipalité de Boulogne, était élevée à la dignité de basilique, à défaut d'être jamais redevenue cathédrale, ce qui était le grand rêve initial de ce constructeur, dont son biographe et ami Daniel Haigneré écrivit qu'il était "une volonté et une conviction."
A l'origine des deux édifices religieux qui se sont succédés à Boulogne-sur-Mer, on trouve cette légende qui s'inscrit dans la tradition médiévale : "en des temps reculés, une statue miraculeusement apportée par les flots vint échouer en un lieu choisi, indiquant aux habitants que là devait s'élever un sanctuaire marial."
Le succès du pèlerinage médiéval entraîna l'embellissement et le remaniement constant de la cathédrale reconstruite à la demande des comtes de Boulogne à partir de 1104 ; vers 1400, la construction du grand portail offert par Jean de Berry "vint ainsi clore trois cents ans de chantier. C'est dans une somptueuse église de pèlerinage que Louis XI, en 1478, proclama la Vierge suzeraine du comté de Boulogne, passé à la couronne. L'acte royal para le sanctuaire d'un prestige accru." L'édifice ne se releva du siège anglais de 1544 et de l'iconoclasme huguenot , en 1567, qu'à partir du règne de Louis XIII. Au XVIIIe siècle, Mgr Partz de Pressy, évêque de Boulogne, fit détruire le portail offert par Jean de Berry et son épouse, Jeanne de Boulogne.
Fermée en 1793, vendue à l'encan en 1798, la cathédrale n'était plus qu'un champ de ruine au début du XIXe siècle.
La reconstruction de Notre-Dame fut l'oeuvre de l'abbé Haffreingue (1785-1871), fils d'un laboureur du Boulonnais, ecclésiastique à la vocation tardive et architecte autodidacte. En 1827, cet amateur se lança avec une détermination inouïe dans cette folle aventure qui devait pourtant arriver à son terme quarante ans plus tard, en dépit des méthodes techniques et architecturales peu orthodoxes de l'abbé. Rien ne passait chez lui par le dessin préparatoire (ses rares dessins témoignent d'une stupéfiante maladresse enfantine), l'étude rationnelle des poussées, mais tout reposait sur un empirisme quotidien et la pratique intime de l'écriture, dont témoigne son vaste journal. La pose de l'énorme coupole de quarante-sept mètres de diamètre, qui suscita tant d'inquiétude, devait marquer l'achèvement du chantier. Sa hauteur demesurée, qui doit beaucoup aux longues heures passées à arpenter le dôme de Saint-Paul de Londres, en faisait un phare symbolique de la catholicité face à l'Angleterre. En 1879, l'église que l'abbé Haffreingue avait légué à la municipalité de Boulogne, était élevée à la dignité de basilique, à défaut d'être jamais redevenue cathédrale, ce qui était le grand rêve initial de ce constructeur, dont son biographe et ami Daniel Haigneré écrivit qu'il était "une volonté et une conviction."