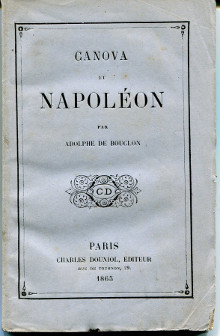Ecclésiastique du diocèse d'Evreux,
l'abbé Bouclon (1815-1882) est l'auteur de nombreux travaux d'érudition, essentiellement biographiques. Ouvrage peu connu, son étude sur
Canova et Napoléon puise essentiellement ses sources dans les écrits de
Quatremère de Quincy et d'
Artaud de Montor, "tous deux intimes amis du grand artiste, dont se glorifie l'Italie, comme Athènes se glorifiait de Phidias." Ce sont les conversations entre les deux hommes qui ont retenu l'attention de
Boulon, fasciné par la fermeté dont fit preuve à plusieurs reprises le nouveau Phidias face aux volontés du César moderne.
"On verra avec un intérêt saisissant d'actualité comment Canova, cet homme si vrai, si judicieux, si ardent dans son amour pour la patrie italienne, envisageait en face du tout-puissant empereur la question romaine de son temps. Les hommes qui osent dire la vérité aux têtes couronnées sont si rares, remarque l'auteur, qu'il est bon de proposer comme modèle et exemple Canova, qui eut ce grand courage."
On n'impose pas de loi au génie, aurait reconnu Napoléon en parlant du sculpteur Canova. Réelle ou apocryphe, la formule est révélatrice des refus réitérés du sculpteur du "beau idéal" de céder à la tentative napoléonienne d'annexer son talent à des fins politiques. "Le gouvernement de Bonaparte, écrit
Quatremère, brigue la faveur d'obtenir l'illustration que donne le génie des arts."
Les deux hommes se rencontreront à deux reprises, en 1802 et en 1810, après que l'artiste s'était fait à chaque fois longuement prié pour quitter Rome.
En 1802,
Canova modèle à Saint-Cloud le
buste du premier consul et obtient l'autorisation de le statufier sous l'apparence de Mars désarmé et pacificateur. Lorsque cette statue arrive enfin à Paris, en 1812, l'empereur, dubitatif devant l'excès d'idéalisation de la nudité et les commentaires qu'elle ne manquerait pas de susciter, juge préférable de soustraire l'oeuvre aux regards . En 1810, le but officiel de la venue de
Canova : modeler le buste de l'impératrice
Marie-Louise, n'était qu'un prétexte pour l'inciter à accepter le poste de "surintendant des arts" que lui propose l'empereur. En vain. Lointain écho des joutes verbales qui marquèrent les séances de pose entre Louis XIV et Le Bernin, les conversations entre les deux hommes relèvent d'une forme inattendue de happening, où le refus de fléchir de l'artiste tend à renverser la source de la souveraineté : la "souveraineté du génie" crée les conditions inédites d'une déligitimation symbolique de la "souveraineté de puissance." Telles qu'elles sont restituées, les discussions qui accompagnaient ces rencontres soulignent, en effet, les indignations patriotiques de l'artiste devant la politique italienne de
Napoléon. Défenseur de la Sérénissime et du pape, Canova n'hésite pas non plus à s'élever devant le pillage des oeuvres d'art par les armées françaises en Italie. "Que votre majesté, reprit
Canova, laisse au moins quelque chose à l'Italie. Ces monuments antiques forment collection et chaîne avec une infinité d'autres qui ne se peuvent transporter ni de Rome, ni de Naples. Rien ne peut remplacer, sous votre ciel nuageux, la vive lumière du ciel d'Italie. Vous avez le cadavre de nos monuments, mais non leur vie."